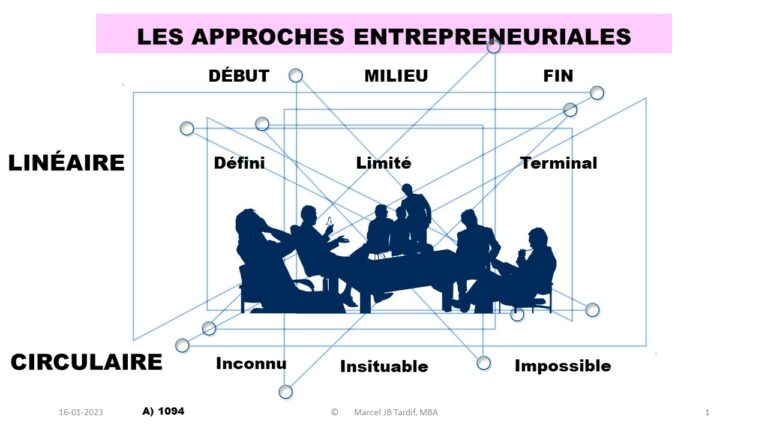Marchand (2010) note que : « Tandis que la cognition est individuelle, le savoir est un processus qui suppose la coordination des interactions entre interlocuteurs et praticiens de la tâche dans l’environnement du travail ».
De fait, comme le souligne Toren (1993), « notre processus cognitif se constitue à travers notre engagement dans le monde et est le produit de notre intersubjectivité avec lui ». Ingold (2000) précise que « le sens n’est pas une pure forme d’imposition sur nous des données perçues, à compter d’un processus inné d’apprentissage ». En fait, dirons Adenzato et Garbarini (2006), « il est généré par notre relation avec le contexte dans lequel nous nous impliquons ». D’ailleurs, c’est de la sorte que les « communautés de pratique » se forment, et que les habiletés et les savoirs qui s’en dégagent s’expliquent.
Les influences subies par chacun, dans son contexte de vie active, ne sont pas souvent conscientes, bien qu’elles ajoutent, par l’incidence de leur apport de savoir (cognition), à notre potentiel d’habiletés propres. Quand les gens travaillent ensemble, dans un même contexte (environnement), ils partagent fatalement des savoirs par l’observation et l’échange entre eux. Or, les « pratiques » professionnelles, que cela permet de développer, sont « contextuelles » et « situationnelles ». Un sens du savoir pratique en découle, qui n’est pas le fruit d’une simple mécanique de transfert des connaissances. Des éléments de contexte et de situation s’y rattachent, parce qu’il y aura eu des interactions, entre les personnes, dans le groupe d’émergence, qui les auront caractérisés. Il y a donc une formation de sens pratique des savoirs, par l’intersubjectivité des rapports entre les personnes qui auront pris part aux relations l’ayant fait naître et l’ayant caractérisée (Ezzy, 2001).
Les dimensions culturelles, inhérentes aux pratiques de l’entreprise, sont importantes, parce qu’elles teintent les savoirs d’un sens particulier d’application, même si les pratiques en question pourront sembler, du dehors, généralisables et transposables ailleurs. En d’autres mots, « les savoirs sont propres aux organisations et à leurs buts » (Garrety, 2008). Ce ne sont pas des structures de connaissance sans renvoi d’alignement sur la personnalité de l’organisation ou du groupe duquel les savoirs seront issus. S’il y a un « sens aux choses de l’humain », il y doit également y avoir un « sens aux choses produites par l’humain » (Rau, 2011).
Ce qui suppose, que le benchmarking, que certains estiment déterminant de pouvoir de concurrence accrue par l’adaptation à la condition spécifique de l’entreprise d’arrivée, présente une faille majeure. On ne peut importer depuis une entreprise de départ, même avec l’intention de l’adapter, une pratique conçue, appliquée et située dans un contexte que la culture de l’entreprise d’arrivée ne supporte pas.
Or, la culture organisationnelle, par essence, est le produit d’une spécificité d’état global d’être dans toute entreprise, et elle ne peut être calquée par aucune autre. S’inspirer des pratiques des autres ne suppose pas, que l’on puisse réussir à revêtir le fond culturel de l’entreprise les ayant fait naître et les ayant appliquées avec succès. D’ailleurs, l’objet de l’activité et des affaires de l’entreprise concurrentielle, quelle qu’elle soit et où qu’elle soit, est de trouver sa vraie nature, et donc ses véritables pratiques d’organisation par des savoirs qui lui seront proprement ajustés.
Chez vous, en entreprise, on développe des « savoirs propres » par l’organisation originale du travail, ou on « importe » les pratiques des autres par le benchmarking?