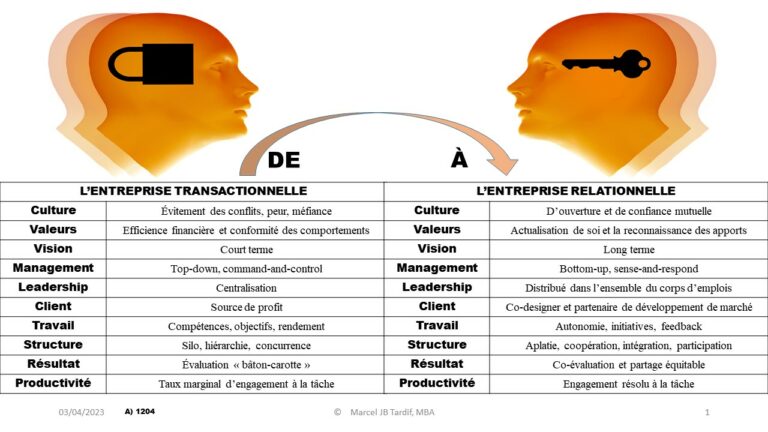Floyd (2008) signale, que « les améliorations industrielles, en Europe de l’Ouest et aux États-Unis, n’adviennent en moyenne qu’à raison de 3 % par année. Soit entre – 3% et + 6 %. Les améliorations de classe mondiale, elles, se produisent plus rapidement, soit au rythme de 10 % ou plus par année. » Il note également que « les améliorations de classe mondiale sont, elles-mêmes, très souvent en porte-à-faux direct par rapport aux objectifs stratégiques des entreprises les adoptant ». Ce qui suppose ce qu’il est convenu d’appeler le cannibalisme dans le « développement stratégique ». Le fait d’abandonner un créneau d’affaires, pour privilégier une avenue nouvelle d’activité, qu’elle soit ou non adjacente au core business courant de l’entreprise.
En fait, le cycle d’innovation, une fois le sommet de la courbe de pénétration atteint, ne permet pas aussi facilement qu’on ne le pense de changer de manière radicale de produit phare voire d’activité fondamentale, surtout si l’entreprise est seule ou presque à écrémer le marché. L’entreprise, suivant la prescription de Chandler (1962), doit s’assurer que ses structures de fonctionnement (interne) suivent ses stratégies de positionnement (externe). Un processus d’harmonisation d’autant plus ardu et coûteux, lorsqu’il implique la totalité ou presque de l’organisation du travail sur l’activité et les affaires de l’entreprise. Il faut prendre conscience, que l’innovation se déploie en plusieurs phases successives, y compris la dernière soit celle de la maîtrise de l’activité et des affaires affectées par elle. Et donc, l’entreprise qui poursuit un objectif de « classe mondiale » ne peut se permettre d’améliorer une partie seulement de ses modes, méthodes et pratiques de gestion à cet égard, ou encore d’occuper temporairement le créneau de marché que cela supposera. Elle doit s’investir pleinement dans sa transformation, pour réussir cette opération.
Ce que les chiffres précités indiquent, c’est que les entreprises de l’Europe de l’Ouest et des États-Unis semblent moins intéressées à innover sur leurs marchés nationaux, déjà acquis et en voie de saturation, qu’elles ne le sont sur les nouveaux, ailleurs dans le monde et souvent peu encombrés. Elles passent de plus en plus en mode « disruption de marché », qu’en mode « disruption d’innovation ». Or, les marchés émergents leur sont généralement moins familiers, partant plus difficiles de pénétration, parce que souvent morcelés et peu propices au « blitzscalling » (Hofmann, 2018). Ce qui leur impose un étalement plus grand que nécessaire à la récupération rapide de leur investissement en transformation de produit ou d’activité et d’affaires propres.
En d’autres mots, la « culture de l’innovation » ne va pas de soi, à bien des égards. Et l’enracinement, dans des modes, méthodes et pratiques de gestion surannés, a pour conséquence la fixation sur la récupération facile du maximum de revenu du marché occupé. Les entreprises, avant de vouloir gérer le monde, doivent commencer par gérer leur propre monde. Et celui-là n’a pas toujours la flexibilité, l’agilité et l’adaptabilité qu’elles ne le voudraient pour passer, du jour au lendemain, de « classe locale, régionale, nationale » à « classe mondiale ». Gérer du profit et gérer de l’innovation ne vont pas obligatoirement dans le même sens, du moins sur le court terme, celui qu’impose la rentabilisation des opérations dans l’entreprise sujette aux pressions quotidiennes des analystes financiers.
Or, les entreprises de l’Europe de l’Ouest, et bien plus encore celles des États-Unis, sont ancrées dans des « économies sur-financiarisées » (Foroohar, 2016; Mazzucato, 2013; Reinert, 2004). Et dans les économies sur-financiarisées, étrangement, on ne « financiarise » plus tant l’activité et les affaires de l’entreprise, par le truchement des innovations, que l’on ne spécule sur le titre à la cote.
La « culture de l’innovation », qui a mené les économies sur-financiarisées à leur stade actuel de développement, s’est érodée au point où les entreprises qu’elles comprennent se « déchaînent les méninges » pour trouver des avenues « d’acculturation de l’innovation » pour… « suivre »!
Chez vous, en entreprise, « on investit dans l’innovation pour assurer le mieux-être de la société d’implantation », ou « on spécule au détriment de cette dernière »?