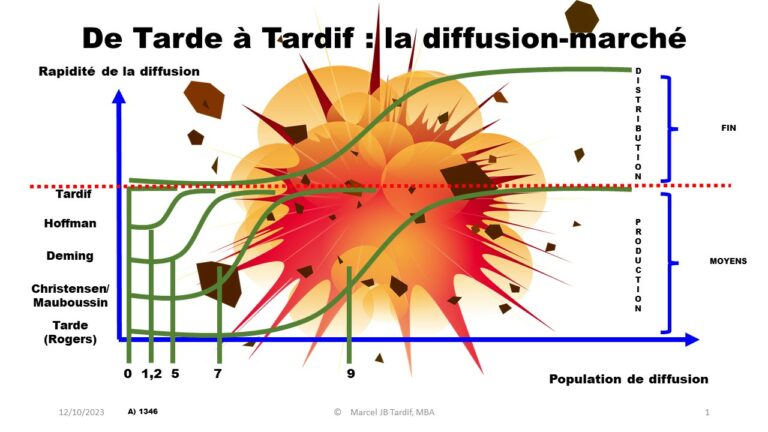La performance s’apprécie en mesures de qualité sur le cycle de vie entier de l’entreprise, contrairement au résultat qui, lui, s’évalue en mesures de quantité sur l’exercice clos. En somme, ce qui fait de l’entreprise une organisation véritablement performante dans son secteur d’activité et d’affaires, c’est sa capacité démontrée de dégager, sur sa trajectoire d’évolution continue, un niveau d’amélioration de ses modes, méthodes et pratiques de management susceptibles de la classer comme première de rang dans son marché.
Il existe trois pôles de référence de la performance globale de l’entreprise (les impératifs de constitution, de fonctionnement et de changement) : 1) les politiques (la gouvernance); 2) les personnes (la gérance); 3) le partage (le risque, l’effort et les retombées).
Les politiques renvoient à la culture organisationnelle, et donc aux référents de cohérence dans l’organisation de la présence-marché de l’entreprise. Les personnes réfèrent au climat du travail, comme facteur de cohésion dans l’action que suppose l’activité et les affaires de l’entreprise. Enfin, la coopération donne la mesure finale, en termes de conséquences sur l’activité et les affaires menées, des capacités, potentialités et opportunités de dépassement du rendement de l’entreprise par rapport à son marché de concurrence. On a là les trois interprétations possibles des impératifs de management de l’activité et des affaires de l’entreprise.
Les impératifs que sont les politiques, les personnes et le partage sont l’objet ordinaire d’inhibiteurs de rendement sur l’activité et les affaires de l’entreprise. Ce qui atteint au résultat d’exercice, et bien évidemment à la performance globale de l’entreprise sur son cycle de vie entier. Les inhibiteurs sont regroupés en importance stratégique, en gestion courante, et évaluation réelle et en récurrence du changement dans l’entreprise.
Les politiques (la gouvernance) sont affectées par une définition standardisée et une diffusion statutaire, au lieu d’être renforcées par une démarche de dotation d’identité propre de la part de l’entreprise. Leur application est trop discrétionnaire et les dérogations trop récurrentes, pour affermir la différenciation de l’entreprise dans son marché. Les politiques font très rarement l’objet d’indicateurs de mesure dans la tableau de bord, et, pire encore, ne sont soumises à aucune sanction suffisante pour redresser la situation suite aux écarts de comportement de l’entreprise. Finalement, il est généralement plus qu’improbable que les politiques soient révisées périodiquement, et si elles le sont, les changement qu’on y apportera seront d’ordinaire marginaux.
Les personnes (la gérance) sont trop souvent sélectionnées par des tiers intervenants d’activité et d’affaires que sont les chasseurs de tête indépendants, lesquels ne vivent ni de près ni de loin les valeurs de l’entreprise. Quant aux mécanismes d’insertion des personnes dans le milieu du travail, ils sont le plus souvent sans mérite aucun en termes d’assurance de concordance culturelle des acteurs en instance de coopération sur l’activité et les affaires de l’entreprise. La promotion des personnes suit trop souvent l’ordre d’entrée en fonction, et la gestion de carrière est laissée aux seuls concernés. Pire encore, la valeur économique, par le truchement des habiletés techniques, l’emporte nettement sur les valeurs sociales des acteurs. Et, en termes d’évaluation de chacun, le rendement constaté ne tient pas compte des accélérateurs et des inhibiteurs de la tâche assignée pour justifier une évaluation des apports raisonnablement honnête. La permanence des personnes est un acquis général d’organisation, peu importe la qualité des apports au résultat, tandis que les mandats de direction sont indûment allongés.
Le partage du risque, de l’effort et des retombées donne lieu à un clivage éhonté, parce que systématique, dans la structure d’emplois de l’entreprise, ce qui tend à maintenir un régime d’iniquité volontaire au sein de cette dernière. Les écarts de rétribution sont indécents et le niveau de désengagement sous-estimé par rapport aux défaillances du système d’évaluation du rendement sur l’activité et les affaires de l’entreprise. L’entreprise ignore l’ampleur des coûts inutiles rattachés au défaut de partage équitable du risque, de l’effort et des retombées et donc finit par déconsidérer la valeur ajoutée des apports réels d’un chacun à son résultat et à sa performance globale sur l’activité et les affaires. Quant aux réformes sur ledit partage, elles sont d’ordinaire de surface, et on ne compte plus les promesses brisées de la direction envers le personnel exécutant l’activité et les affaires de l’entreprise.
La théorie de l’organisation est tellement influencée par l’obsession de la « performance à tout prix », qu’on en vient à penser que tout ce qui s’ajoute au résultat par rapport aux objectifs de réalisation constitue un rendement justifiant la désignation « d’entreprise performante ». Or, comme en comptabilité des opérations, le régime d’évaluation du rendement de l’entreprise devrait comprendre les actifs et les passifs. C’est-à-dire les « inhibiteurs » et les « accélérateurs » du rendement. Le rendement net est tout ce qui compte, parce qu’il décide du rang-marché de l’entreprise dans son secteur d’activité et d’affaires. Et que la seule performance globale qui compte est celle qui permet à l’entreprise de se classer dans le premier décile de son secteur de référence. Le reste, c’est de la poudre aux yeux pour naïfs de l’évaluation financière.
Chez vous, en entreprise, on tient compte des inhibiteurs du rendement, ou on s’en tient aux seuls accélérateurs de la performance… pour mieux justifier les choix de sa direction?