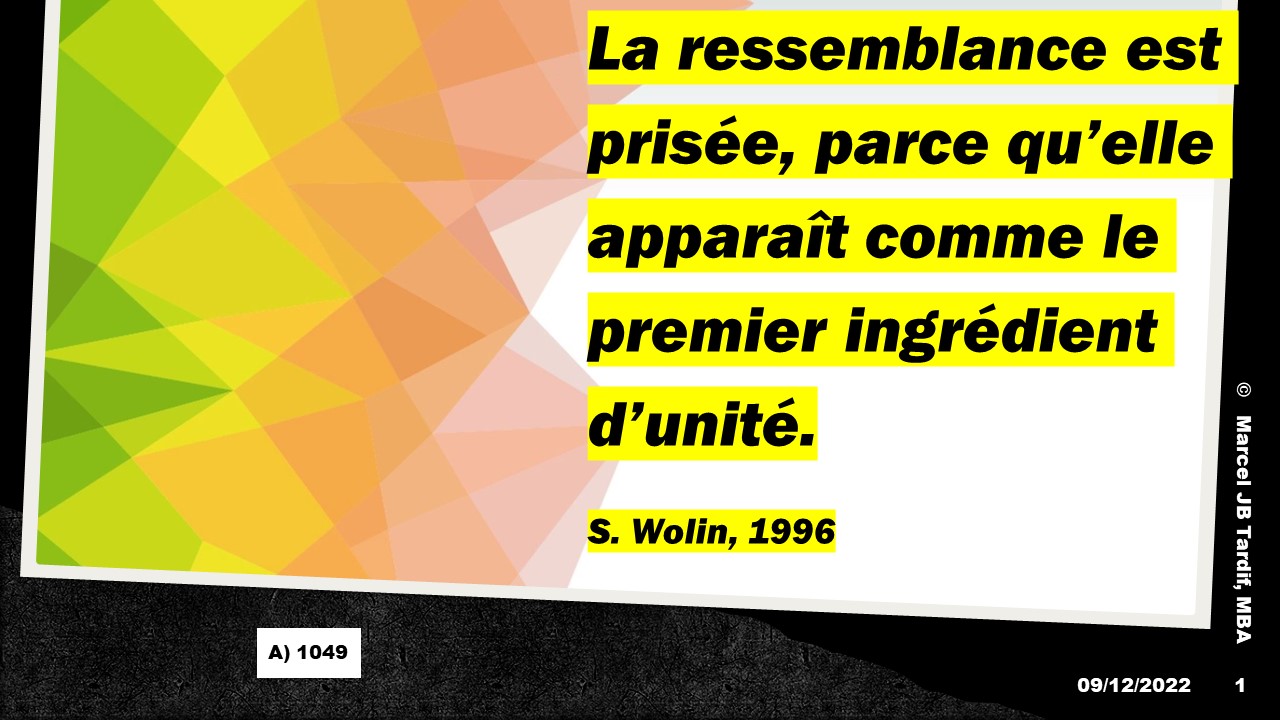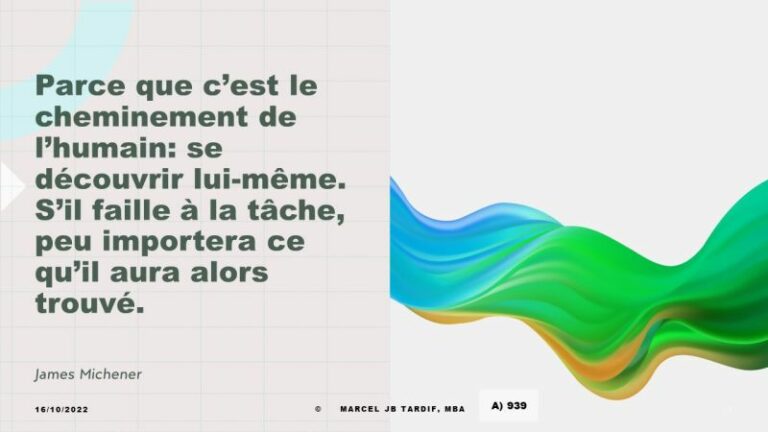Wollin (1996) souligne que « la ressemblance est prisée, parce qu’elle apparaît comme le premier ingrédient d’unité ». Nelson (2003) distingue, en théorie de l’économie conventionnelle, entre les organisations « séparatives », soit celles autonomes et à acteurs rationnels engagés dans la maximisation de leurs intérêts propres (le profit), et les organisations « solubles », soit celles qui voient au-delà d’elles-mêmes pour atteindre l’intérêt plus large de la société. À l’intérieur des deux types d’organisation, on retrouvera trois profils de personnes qualifiées par la nature de leurs relations :
- Les « séparatives-séparatives », soit les personnes qui, le plus souvent fondatrices de l’organisation, agissent comme agents plus ou moins indépendants et sont centrées sur leurs intérêts premiers;
- Les « solubles-solubles », soit les personnes capables de poursuivre un intérêt qui dépasse le leur propre pour atteindre celui collectif de leur communauté;
- Les « séparatives-solubles », soit les personnes qui sont centrées sur l’intérêt de l’organisation à raison des contrôles qu’exercent sur elles les structures hiérarchiques de pouvoir.
Par ailleurs, Friedman (1977) a identifié une catégorie de personnes additionnelle qu’il nomme « unitaristes », qui sont autonomes, mais « capables de fondre leurs intérêts dans celui plus large de leur communauté propre » (Hodson, 2002). Ce qui manque, comme considération de fond, selon Nelson, dans chacun de ces cas, c’est que des organisations peuvent avoir la capacité d’engager leur monde (direction et personnel) de manière responsable, à cause du sens qu’elles présentent à leurs yeux. De fait, ce genre de classification n’insiste pas suffisamment sur les notions « de relations et de motivations », qui sont institutrices « d’unité » dans l’organisation, et donc inhérentes aux personnes de type « solubles-solubles », en ce qu’elles favorisent la poursuite commune d’intérêts. Or, ce qui fait l’efficience interne des organisations ce sont « les rapports harmonieux entre les acteurs » (Overvold, 1987), qui font que les valeurs de l’ensemble ne soient pas subordonnées indûment aux intérêts particuliers d’aucun des acteurs qu’elles comprendront.
Il faut, par ailleurs, prendre conscience, comme l’a rappelé Janis (1972), que le « groupthink » peut faire dérailler toute considération sur la situation, à la faveur d’un parti-pris des acteurs sans commune mesure avec la réalité des faits. Il convient donc, dans l’organisation, qui veut accomplir sa mission implicite de service optimal au marché, de rassembler des personnes de types différents, mais dans la concordance de la fin de son activité et de ses affaires. En somme, il faut pouvoir « remettre en cause » les voies et les moyens de l’activité et des affaires, sans déroger au principe du service supérieur à la communauté propre. Ce qui n’est pas simple à réaliser, les humains ayant tendance à user du pouvoir à leurs fins personnelles, dès qu’il existe et qu’il peut leur servir (le principe du fusil de Tchekhov).
Si « l’unité » est indispensable à l’économie des voies et moyens de l’activité et des affaires de l’organisation, donc d’un point de vue interne, la « remise en cause » est incontournable à l’économie de la fin de l’organisation, donc d’un point de vue externe.
In fine, tout est question d’équilibre, parce que l’innovation, sans laquelle l’organisation s’enlisera dans l’inefficience de la réédition permanente de son service à un marché en concurrence, repose sur le va-et-vient interminable entre « l’unité » et « la remise en cause » des idées, des décisions et des actes.
Chez vous, en entreprise, il y a place pour « l’unité » et pour « la remise en cause », ou il n’y a ni « unité » ni « remise en cause »?