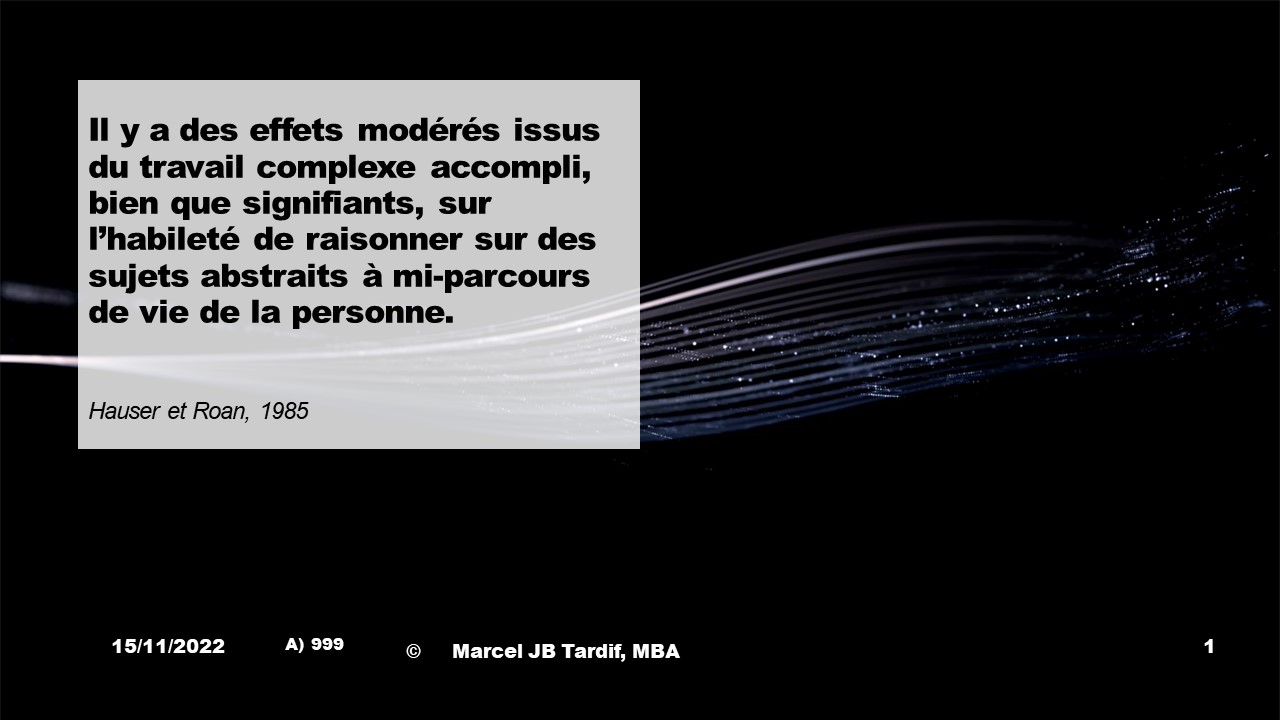Yeoman (2014) cite Hauser et Roan (1985) qui disent que : « Il y a des effets modérés issus du travail complexe accompli, bien que signifiants, sur l’habileté de raisonner sur des sujets abstraits à mi-parcours de vie de la personne ». Ce que la Wisconsin Longitudinal Study (2007) a démontré.
Kornhauser (1965) avait déjà établi, que la santé mentale des travailleurs se détériorait « dès lors que la tâche passait du type habileté et responsabilité requises à un type moins exigeant de travail ». Non seulement la santé physique était-elle atteinte, mais la santé mentale l’était également. D’ailleurs, les études Whitehall I et II (Bosma et al., 1997) ont démontré, que « le manque de contrôle sur la tâche, dû au statut du travail, augmentait les problèmes cardiaques chez les sujets visés ».
Dans le cas du « travail complexe », qui exige « pensée » et « jugement », l’incidence sur la santé des travailleurs est moins grande, parce que, justement, le « contrôle de la tâche » est exercé directement par les personnes concernées. Ce qui prouve, que la santé mentale et physique des employés n’est pas déterminée uniquement par la nature de la tâche, mais surtout par le contrôle sur le travail qu’elle suppose. Or, dans l’entreprise actuelle, suite à l’introduction massive des machines, dites « intelligentes », on assistera, de plus en plus, à une perte de contrôle sur la tâche par les travailleurs eux-mêmes, au profit d’une simple supervision répétitive et lassante par les derniers des patterns de décisions-actions des premières. Ce qui diminuera le « sens de l’utilité de soi », chez les travailleurs, et tendra à en faire des « prolongements techniques » des machines qu’ils auront moins à contrôler qu’à platement suivre dans l’accomplissement de leurs fonctions de production.
La direction de l’entreprise consacre, généralement, plus de fonds aux « équipements », en termes d’investissement annuel, qu’aux « personnes ». Or, le même investissement dans les « personnes » rapporte, en termes de productivité, 2,2 fois plus que dans les « équipements », soit 8,5 % contre 3,9 % (Keiningham, Aksoy et Williams, 2009).
L’approche de l’économie par la « sur-financiarisation » des marchés (Eisinger, 2012) s’est traduite, depuis 1980, en une approche de l’entreprise par la « sur-financiarisation » de l’activité et des affaires. L’entreprise, en moyenne (du moins aux États-Unis), investit de moins en moins dans la recherche et le développement, comme elle investit de moins en moins dans ses modes, méthodes et pratiques de management. Et le personnel est devenu le cadet de ses soucis.
Pourtant, l’entreprise-type se targue d’être « orientée-clients ». Le problème, c’est qu’elle ne se reconnaît jamais qu’une seule raison d’être formelle, soit la valeur ajoutée à l’actionnaire (Business Roundtable, 1997). En somme, ni le client ni le personnel ne retiennent son attention, seul l’actionnaire y parvient (en fait, on devrait dire le dirigeant-actionnaire).
D’autre part, l’entreprise-type insiste sur l’impératif d’engagement à la tâche de la part de tout son personnel. Or, l’engagement au travail tient non seulement de la qualité de la tâche elle-même (en termes de « signification »), mais également du cadre de référence de l’emploi, décliné en modalités de gestion de l’activité et des affaires de l’entreprise. Ce qui veut dire qu’une attention préférentielle aux « équipements », de la part de l’entreprise, renvoie au personnel l’impression très nette qu’il n’est rien d’autre qu’un second violon dans l’ordre de son activité et de ses affaires. Et donc, il ne s’investira pas plus que l’entreprise n’investira en lui, et son niveau d’insatisfaction suivra très précisément la courbe de désintérêt de l’entreprise à son égard.
Chez vous, en entreprise, on « habilite le travailleur », ou on le « déshabilite » par la « décomplexification à outrance de la tâche »?