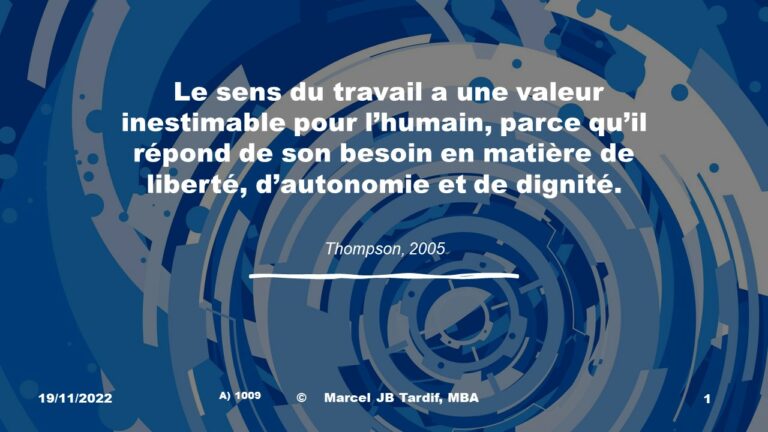Bentham (1776) énonçait que « le succès porteur d’avenir, compris en termes de mieux-être, répond d’un standard d’action. Et le fardeau de la preuve repose sur les épaules de tout critique, de démontrer qu’il y avait un autre standard à satisfaire ».
Dans l’entreprise, qui sait assumer pleinement et continument sa mission implicite de service optimal au client, la dimension sociale du « mieux-être », qui s’y rattache pour ce dernier, doit répondre du « standard d’action » à imputer à la définition du « succès porteur d’avenir » par son activité et par ses affaires. En d’autres mots, la « preuve de l’utilité sociale de l’entreprise » (voir mon post sur John Stuart Mill, sur LinkedIn ce même jour) doit se déduire de la « juste critique » de son service au client.
Le fardeau de la preuve du « succès porteur d’avenir », pour la société d’implantation de l’entreprise, est à démontrer par celle-ci, et ce à compter de « l’utilité sociale » de son service au client. Le « standard à satisfaire », pour l’entreprise, n’est pas d’enrichissement économique pour l’actionnaire et le dirigeant, mais de satisfaction sociale en termes de mieux-être du client.
On inverse « fin de l’entreprise » et « moyens de l’activité et des affaires », dès lors que l’on suppose que le management de la ressource engagée dans l’activité et les affaires doit produire du résultat financier avant du mieux-être social. Bien sûr, les entreprises, sous la pression des groupes de revendication, ont donné dans le discours sur « la responsabilité sociale », en adoptant des codes à cet effet. Mais leur préoccupation première, tel qu’en fait foi leur rapport annuel, est ailleurs.
L’entreprise mesure de la valeur économique, bien qu’elle prêche, par énoncés corporatifs interposés, des valeurs d’engagement social et durable. Ce qui est durable, dans l’appréciation du « succès » de l’entreprise, ce n’est pas tant ce qui peut être « porteur d’avenir » pour la société, partant pour le client, mais ce qui est immédiatement générateur d’enrichissement pour ses actionnaires et ses dirigeants. Et c’est en cela, qu’il y a cul par-dessus-tête dans l’articulation de l’effort de gestion de ses ressources engagées sur opérations d’une part et dans la répartition des retombées sur son activité et ses affaires d’autre part.
L’entreprise n’a pas appris à « se critiquer » elle-même, comme le commanderait un management responsable de sa « fin » et de ses « moyens ». Son « standard d’action » est limité à la mesure financière de son résultat financier, alors qu’il devrait découler de son engagement de mission à servir de manière optimale le marché.
L’entreprise agit à l’avantage de ses « moyens », partant au détriment de sa « fin ». S’il en était autrement, on verrait, dans ses rapports annuels, une masse d’informations de portée sociale, au lieu d’y relever une infinité de données chiffrées à saveur « d’ingénierie financière ».
L’entreprise gère ses opérations par indicateurs de performance interposés, pour ajouter à son profit d’exploitation de la ressource engagée dans son activité et ses affaires, sans assumer pour autant son obligation morale d’optimisation de son service au marché. Son « succès » est rarement moral dans son évaluation de ses opérations, bien que toujours financier dans son appréciation du résultat d’exercice.
L’entreprise, en parfaite contradiction avec son mandat implicite de service optimal au marché, n’entend pas dégager par-dessus tout du « mieux-être » à partager avec les autres (client, personnel et communauté), mais veut accumuler par-delà toute chose du « plus-avoir » à distribuer à certains (actionnaires et dirigeants).
Chez vous, en entreprise, « le succès porteur d’avenir » s’apprécie en mieux-être social pour la multitude, ou « le succès porteur d’avenir » se mesure en plus-value pour les intéressés au contrôle de son activité et de ses affaires »?