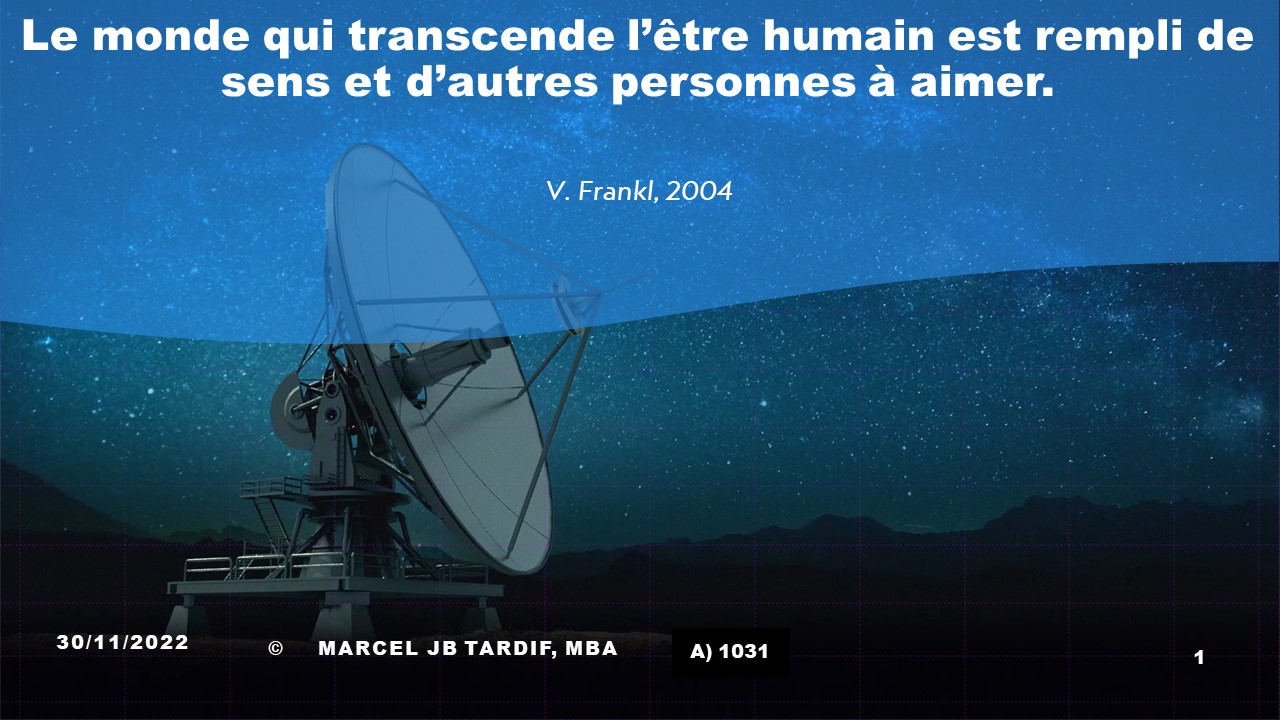Frankl (2004) indique que « Le monde qui transcende l’être humain est rempli de sens et d’autres personnes à aimer ». L’humain n’est pas un simple technicien des solutions pratiques, mais avant tout un être de relations avec son milieu et les semblables qui s’y trouvent. Il doit y avoir un « sens de l’autre », dans son environnement, pour qu’il s’y retrouve lui-même, et participe à l’évolution de son genre.
Ce qui suppose, que chacun ne doit pas (ne peut pas) se contenter de s’imposer en permanence aux autres, mais agir par le groupe pour demeurer parti du genre humain. Et sans ce genre, il n’existe pas. Aussi, cherche-t-il à donner du « sens » à sa vie, en injectant du sens additionnel dans son espace-temps de vie active. Pour ce faire, il conçoit, discute et adapte tout ce qui peut faire de lui un être plus sociable encore. Il a le « pouvoir de nommer » (Daly, 1973) les choses, partant de « définir » et de « redéfinir » le monde.
L’humain, pour grandir, et donc atteindre un état d’être supérieur, doit entretenir des rapports de correspondance avec ceux et celles de son entourage qui sont, comme lui, en instance de « recréer le monde social et matériel » (Tirrell, 1993). Le genre transcende l’individu, et ce dernier n’y trouve son sens que s’il élève sa condition finale d’état propre. En somme, le genre est non seulement plus grand que l’individu, mais il doit appeler ce dernier à s’élever en condition humaine, si celui-ci doit pouvoir continuer à « définir » et « redéfinir » ce premier. Et l’individu ne peut « se définir » que par comparaison à ses semblables de genre. Or, l’individu ne gagnerait rien à demeurer stable dans son état d’être courant. Pour s’élever en condition humaine, l’individu doit avoir avec ceux de son genre des rapports qui le feront se dépasser personnellement. Ce qui suppose, qu’il devra, lui également, trouver raisonnance auprès des autres, dans sa quête d’amélioration de condition propre.
Or, pour ce faire, l’individu doit « aimer » les autres. Et donc leur trouver le « sens » qui le fera se dépasser lui-même, s’il veut avancer en condition humaine par l’échange avec eux. Ce qu’il ne peut réussir, que s’il se rapproche des autres, pour partager avec eux plus de conditions sociales propices à leur amélioration réciproque.
En entreprise, cela supposera, que des mécanismes de socialisation existent qui autoriseront des échanges francs et directs visant la « redéfinition des choses » par l’apport de chacun à l’avantage de l’ensemble. Le contexte culturel de l’entreprise devra alors reposer sur un fond de confiance aussi manifeste que permanent, pour que les rapports entre chacun donnent prise à cette « redéfinition du monde » par l’ensemble concerné. La direction ou la supervision ne peut tout décider, et s’attendre à ce que le « commun » se dégage d’une formule d’imposition sur les autres de l’entendement des « choses redéfinies » soi-disant au profit de l’ensemble.
La gestion participative, que cela évoque, n’est pas un moyen pour le personnel de saquer le prétendu « droit de gérance » imputé à la direction. C’est, au contraire, une voie d’assurance, par le groupe, de la conjonction d’effort entre chacun, en vue de faire avancer les choses dans l’entreprise.
Ce qui suppose, que l’entreprise, comme corps social, transcende l’individu, sans lequel, par ailleurs, il n’y aura pas de rattachement au genre humain. On doit donc comprendre, que l’entreprise doit dégager un « sens » supérieur pour l’individu qui y œuvre, pour que l’humain qu’il est s’y réalise en se dépassant en condition propre. Ce qui ne peut se faire que par le rapprochement de chacun avec les autres, dans une quête commune de « redéfinition de leur monde ».
Chez vous, en entreprise, on « redéfinit le monde ensemble », ou « chacun pense le monde pour les autres »?