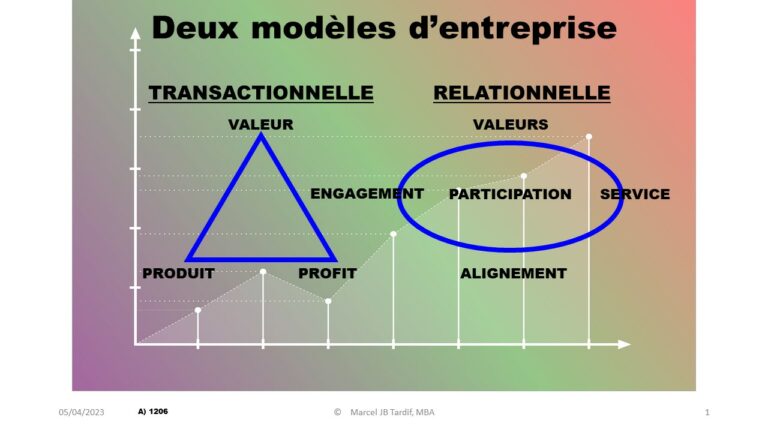Schwartz (1982) pose que « les travailleurs sont payés pour atteindre aveuglément des objectifs fixés par d’autres, à compter de moyens que ces derniers jugent adéquats ». Du moins, pense-t-on généralement, était-là la manière de faire les choses, sous l’empire du taylorisme imputé hier au management de l’entreprise. Mais à vrai dire, ce mode domine toujours le décor dans l’entreprise-type d’aujourd’hui. Le travail y est décomposé, pour le personnel, en segments de tâche pour l’activité (les moyens), alors que, pour l’entreprise, la réponse à la demande du client (la fin) doit se traduire en flux d’utilité pour les affaires. Cela suppose, que le management de l’entreprise, sous ses rapports de production/distribution, est discordant. Alors qu’il devrait s’articuler en mode « sense-and-respond » (Gothelf et Seiden, 2017), il se décline en mode « command-and-control » (Burns et Olson, 2022).
Le management est abordé, dans l’entreprise-type, comme une série de techniques à normer, standardiser et régler pour dégager un profit d’opération, quand il devrait être traité comme une logique de concordance de pratiques innovantes devant servir une demande unique. En d’autres mots, les voies et moyens de l’activité ne devraient pas être figés, même si la fin de l’entreprise, elle, doit demeurer fixe. Or, dans l’entreprise-type, on demande aux travailleurs d’atteindre des objectifs de performance, auxquels ils n’ont pas été associés au départ de leurs mandats d’emploi, tout en les privant de trouver les meilleurs voies et moyens de les satisfaire. Ce que Pruijit (2000) appelle « la séparation de la conception et de l’exécution » (termes que Taylor, 1911, n’aurait pas récusés).
Par contre, l’entreprise, en fait sa direction, estimera que les travailleurs doivent être efficients à la tâche, bien que contraints de respecter à la lettre les directives de travail contenues dans des manuels de pratique inviolables. C’est tout comme escompter le mieux à compter du pire.
Chacun aimerait penser, qu’il puisse effectivement disposer au travail de l’autonomie nécessaire pour accomplir sa tâche avec le niveau de performance le plus élevé qui soit. L’entreprise reprochera, à l’évaluation annuelle de la tâche, les écarts de rendement sur l’activité dégagée par les travailleurs, bien qu’elle ne tiendra pas compte des limites d’initiative au travail que ses normes, standards et règles leur auront imposées.
En somme, ce que Schwartz avance est doublement valide: « Les travailleurs sont payés pour atteindre aveuglément des objectifs fixés par d’autres ». Et « à compter de moyens que ces derniers jugent adéquats ». Or, le sens du travail consiste (devrait consister), par l’autonomie complète à la tâche, en une quête d’innovations sur les voies et moyens d’accomplissement du travail avec le lot d’erreurs que cela peut comporter.
Dans les faits, l’entreprise-type voudrait que les travailleurs usent d’une meilleure intelligence dans l’exécution de leurs mandats d’emploi, sans accepter, en contrepartie, que l’innovation sur la tâche emporte le risque d’erreurs de parcours.
On finit par conclure, que « les objectifs fixés par d’autres » pour exécuter ses mandats d’emploi sont la dimension d’évocation la plus choquante pour le personnel embauché pour son intelligence, alors « les moyens les plus adéquats » de rendre l’activité sont l’illusion la plus incriminante de libéralité ratée pour la direction de l’entreprise.
Chez vous, on « fixe les objectifs » et « contraint les moyens » de la tâche, ou on « libère les esprits » et on autorise « l’innovation et son risque d’erreurs »?