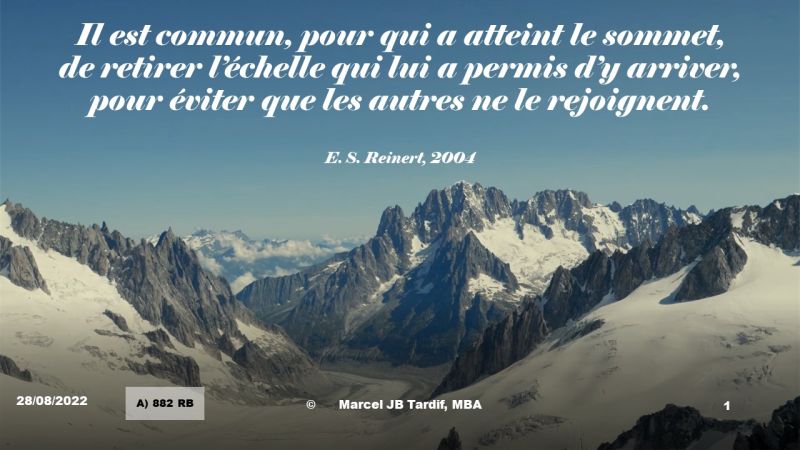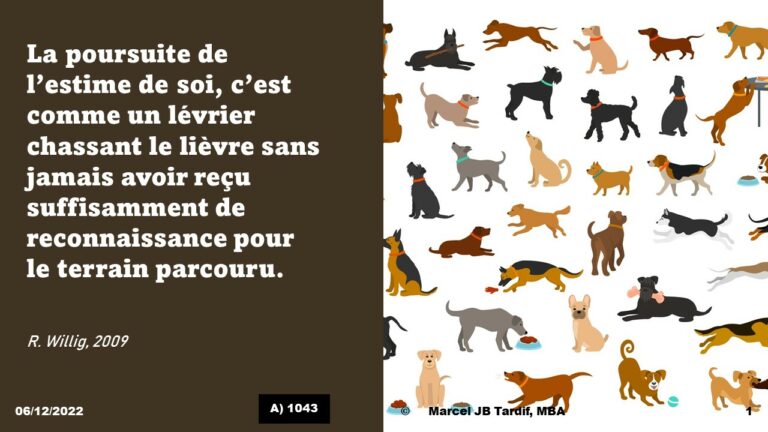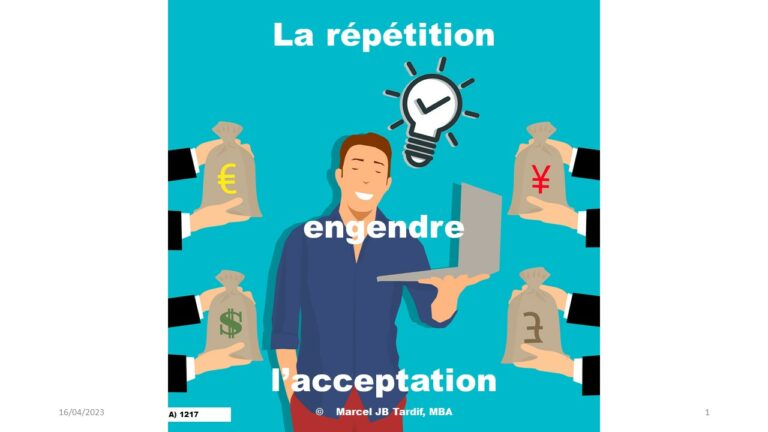Reinert (2004), traitant du développement, hier, et sous protectionnisme fidèlement assuré, des grandes économies d’aujourd’hui, porte à notre attention “qu’il est commun, pour qui a atteint le sommet, de retirer l’échelle qui lui a permis d’y arriver, pour éviter que les autres ne le rejoignent”. Ce qui est bien le cas des économie américaine, anglaise, française et allemande, pour ne nommer qu’elles. On sait que, à travers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’Organisation mondiale du commerce, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles font des pieds et des mains, pour imposer, aux pays encore en développement, l’ouverture de leurs frontières à leurs exportations (biens, services et surtout capitaux), alors qu’à leur stade de croissance ces mêmes pays pratiquaient allègrement le protectionnisme tous azimuts. En somme, parvenus au stade de renforcement approprié de leurs secteurs de prédilection, ils trouvent désormais normal de revendiquer le libre échange avec les pays de leur désignation.
En entreprise, on rencontre également ce type de situation. De fait, ceux qui, hier, pratiquaient sans vergogne la rétention de l’information utile à leur élévation dans la structure d’emplois, veulent, une fois atteint le niveau supérieur de la hiérarchie de leur entreprise, forcer les autres à partager leur propre information, de sorte qu’ils ne puissent s’en servir à leur encontre. Or, l’objet de l’entreprise n’est pas de favoriser un quelconque jeu de souque à la corde entre les personnes, par niveaux d’emploi interposés, mais d’assurer l’exécution des mandats d’activité et d’affaires de cette première au meilleur avantage de l’ensemble de ses acteurs. Ce qui suppose que, au lieu d’évaluer la capacité d’attraction pour soi des ressources disponibles (information comme toute autre), par les uns et ce au détriment des autres, elle évaluera et récompensera, en lieu et place, l’effort coordonné d’accomplissement de sa mission par l’ensemble.
Les évaluations à la tâche sont généralement faites sur une base individuelle, alors que le flux du travail, que suppose l’activité et les affaires qui la comprennent, est une affaire d’entreprise globale. Le problème, c’est que l’évaluation individuelle suscite des comportements individuels, alors que l’activité et les affaires de l’entreprise imposent un partage du risque, de l’effort et des retombées du travail entre tous. Au final, l’entreprise, qui la pratique, entretient en son sein la “concurrence” entre acteurs, alors que celle-ci devrait être réservée au marché où se situent ses rivales d’offre au client. Et à tout inverser, l’entreprise en vient à régresser vers la moyenne des retardataires de marché, au lieu de se loger parmi les premières de rang dans son secteur de référence économique.