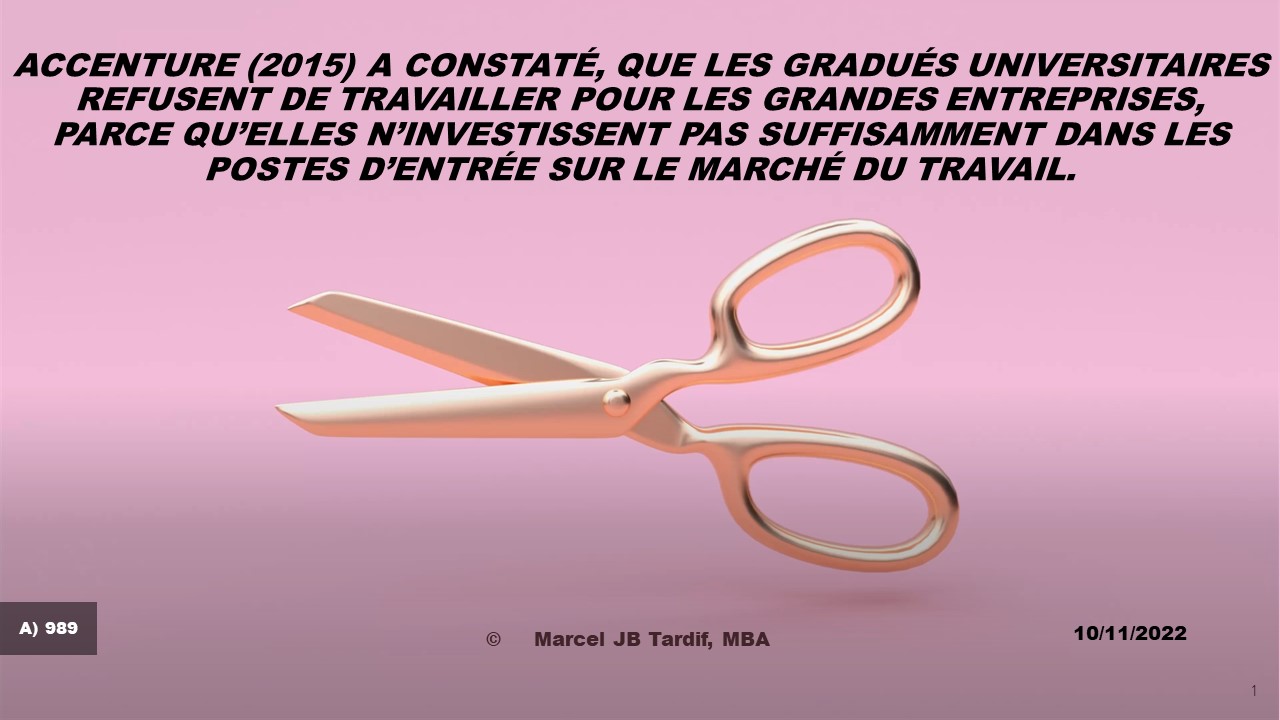Zak (Trust Factor, 2017) note que « Accenture (2015) a constaté que les gradués universitaires refusent de travailler pour les grandes entreprises, parce qu’elles n’investissent pas suffisamment dans les postes d’entrée sur le marché du travail ».
Les gradués universitaires préfèrent, et de loin, travailler pour les STEM (Science, Technologies, Engineering, Math).
Bien que les entreprises, à l’échelle mondiale, disent d’un commun accord miser sur la rétention et l’engagement des meilleurs talents, elles n’investissement, en moyenne, que 31 heures de formation dans leurs nouvelles recrues (Deloitte, 2015). Les entreprises qui investissent plus, selon l’Association of Talent Development, le font à hauteur de 49 heures en moyenne.
Or, l’investissement, dans la formation d’entrée en fonction du personnel, explique 72 % de la confiance dans l’entreprise.
Si l’embauche, comme modalité de sélection du personnel, importe, la rétention ne devrait pas moins être déterminante du succès sur l’activité et les affaires de l’entreprise par la suite.
Trente-trois pourcents des directeurs de Ressources humaines, en 2015, estimaient que la rétention était critique pour le moral des collègues de travail. Ceux qui doivent compenser pour les carences de main-d’œuvre durant la vacance des postes latéraux, et subir, par la suite, le choc des départs précipités des autres. Or, vingt-cinq pourcents des employés disent « vouloir quitter leur emploi dans les douze mois de leur embauche ».
La guerre des talents (Josh Bersin, 2014) ne fait que commencer. Et le rythme d’évolution des technologies de remplacement ne fait qu’accentuer le besoin, déjà aigüe, de mise à niveau des talents, ne serait-ce que pour soutenir la concurrence dans le marché de l’entreprise.
Trente-trois pourcents du personnel en place estiment que leurs habiletés inhibent leur productivité, partant les privent d’avancement en emploi. Et les trois-quarts des employés en poste n’ont pas en main de plan très précis de développement de carrière, alors que seulement trente-et-un pourcents estiment que leur employeur leur ait effectivement assuré la formation nécessaire pour répondre aux exigences de leur travail actuel. Or, pour vingt pourcents des « plus jeunes », ce qui importe le plus c’est « un milieu du travail où assurer leur développement professionnel » (Kegan, 2014).
Zak a donné à son ouvrage le sous-titre évocateur suivant : « The Science of Creating High-Performance Companies ». Il y traite, sommairement, de « l’oxytocin », un neuropeptide (sorte d’hormone), qui a un rôle connu chez les êtres humains, notamment en ce qui concerne la confiance, l’empathie et la générosité.
En 2012, dans son livre The Moral Molecule, Zak faisait déjà état de douze années de recherche sur les inhibiteurs d’émission d’oxytocin en milieu du travail. En 2001, il avait démontré qu’une forte culture de la confiance était l’un des plus puissants prédicteurs de santé économique d’un pays (partant d’une entreprise).
Gallup, dans ses études internationales sur le taux moyen d’engagement au travail, a établi que les employés résolument engagés à la tâche étaient vingt-deux pourcents plus productifs que les autres (Zak, 2016).
Laszlo Bock (2015), vice-président sénior People Operations, a reconnu que « la culture sous-tend tout ce que fait Google ». Et la culture sans confiance universelle, permanente et inconditionnelle entre les acteurs, c’est la coquille vide des rapports interindividuels dans l’entreprise qui se prétend encore productive.
Chez vous, la « confiance existe dès l’embauche » ou « n’existe jamais depuis l’embauche »?